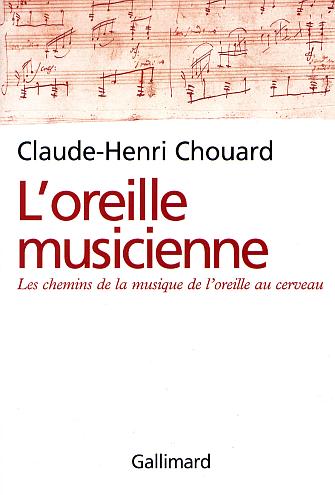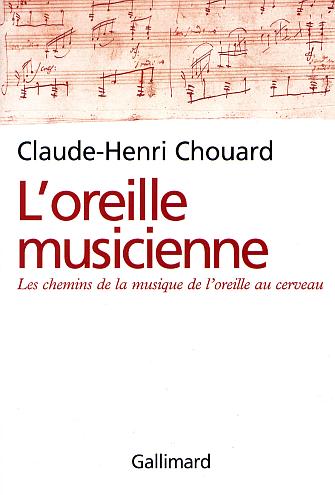
L’OREILLE ABSOLUE..... TOUTE LA VERITE
De nombreux musiciens considèrent l’oreille absolue comme un don
précieux. Quelle est son origine ? Peut-on l’acquérir ?
Ce qui est gagné en efficacité n’est-il pas perdu en plaisir
musical ? Eléments de réponses... Franck Ernould
N’est-il point troublant de se trouver confronté à une sorte
de fréquence-mètre ambulant qui nomme instantanément la
note, voire l’accord que l’on vient de jouer sur son instrument.
N’est-il pas vexant de s’entendre dire “tu es trop bas d’un
quart de ton”, et de voir ce verdict péremptoire confirmé
par son accordeur électronique. De même, n’est-il pas humiliant,
lorsqu’on sue sang et eau sur une dictée d’accords à
quatre sons, d’observer certains surdoués de la classe de musique
la retranscrire d’un seul jet. Mais d’abord, qu’est-ce donc
que cette oreille absolue quasi-mythique, dont certains vont jusqu’à
réfuter l’existence ?
Comment ça marche ?
Rappelons d’abord sommairement le principe actuellement admis de la perception
des hauteurs. Dans notre oreille interne se trouve un organe capteur appelé
le limaçon. En forme de spirale, il est couvert de cellules ciliées
répondant chacune à une zone de fréquences particulière
(selon la théorie d’Helmholtz). L’interprétation des
fréquences, et donc de la mélodie, a lieu principalement dans
la partie droite du cerveau, sa partie gauche traitant plutôt ce qui est
langage. Partant du principe que le musicien doté de l’oreille
absolue associe instantanément un nom de note (Fa, Sol, Ré...)
à la hauteur qu’il perçoit, il est tentant de penser que
ce don proviendrait d’une capacité à faire communiquer les
deux parties du cerveau. Cette hypothèse est infirmée par le fait
que certains chercheurs ont montré que le planum temporal - région
du cortex - des “absolutistes” était beaucoup plus développé
à gauche qu’à droite. Cette asymétrie est-elle innée
ou acquise ? Nul ne le sait. Ceci étant dit, certains prétendent
que de donner à son bébé une clochette en “La”
le dotera à coup sûr de cet atout enviable. Amis lecteurs et parents
de fraîche date, nous vous invitons à tenter l’expérience
et vous donnons rendez-vous d’ici quelques années... Enfin, un
chercheur américain a affirmé, en 1991, qu’il avait découvert
des familles à oreille absolue : il semblerait donc que celle-ci se transmette
comme un trait dominant de génération en génération.
Le gêne correspondant serait présent chez un individu sur 1500,
mais elle ne se manifesterait que pour un petit nombre d’entre eux.
L’oreille absolue serait donc un don, comme les yeux bleus ? Pas si simple
! D’autres études, statistiques celles-là, démontrent
que 95% des musiciens doués de l’oreille absolue ont commencé
la musique avant sept ans. A cet âge, le développement neuronal
et cortical est encore en cours : on pourrait donc croire que l’oreille
absolue s’acquiert. Jusqu’à un certain âge seulement
: les faits montrent que d’aborder la musique après onze ans prive
d’oreille absolue, et les adultes parvenant à l’acquérir
après coup sont rarissimes. On a également remarqué que
ce “don” était plus fréquent chez les musiciens non-voyants,
dont l’ouïe est de toute façon beaucoup plus fine, oreille
absolue ou pas. Enfin, la dégénérescence de l’oreille,
à la suite de maladies du cerveau, peut avoir des conséquences
dramatiques sur la perception des hauteurs. Par exemple, Gabriel Fauré,
à la fin de sa vie, entendait tout atrocement faux, ce qui est un véritable
supplice pour un compositeur. Certaines oreilles absolues voient leur référence
baisser inexorablement avec l’âge, ce qui les conduit à tout
percevoir trop haut...
Piano absolu et oreille absolue
Les dictées musicales sont, nous l’avons vu, un mets de choix pour
les “absolutistes”. Là où une oreille normale a besoin
qu’on lui rappelle sans cesse le La de référence et travaille
par comparaison entre cette référence et la note entendue, l’oreille
absolue s’en passe allègrement. La plupart de ceux qui en sont
dotés sont d’ailleurs capables de chanter à tout moment
un La juste. Facile à vérifier : la tonalité du téléphone
est un La 440 tout à fait précis.
Certains reconnaissent les variations spectrales, et non la hauteur. Par exemple,
le spectre d’un son de corde à vide varie selon la tension de cette
dernière. Ainsi, il n’est pas rare que des violonistes, entre autre,
accordent leur instrument sans aide extérieure, du fait qu’ils
aient développé une mémoire spectrale, a priori sans aucun
rapport avec une mémoire des hauteurs. Dans le même ordre d’idées,
d’autres instrumentistes sont spécialisés sur leur instrument
: ils nomment instantanément les notes jouées au piano par exemple,
mais restent cois dès qu’on les joue sur une trompette. Leur “oreille
absolue” est en fait un analyseur de timbre très poussé.
Le nombre de notes reconnues simultanémént (accords) est également
très variable. Des “phénomènes” analysent note
par note des clusters atonaux comportant parfois plus de dix notes sans en rater
une seule ! Plus fort encore, des “exceptions” décomposent
même les bruits en suite de hauteurs, se plaignant dès qu’une
porte grince, parce qu’elle n’est pas consonante !
Atout ou handicap ?
Cette analyse, involontaire certes, mais très fine et permanente, ne
nuit-elle pas au plaisir musical ? En d’autres termes, aime-t-on encore
écouter de la musique si l’on ne peut s’empêcher de
l’entendre comme une suite de notes parfaitement identifiables ? A cela,
on peut apporter plusieurs réponses. Premièrement, l’oreille
absolue, très analytique, permet de suivre les polyphonies les plus complexes
en temps réel, de reconnaître les sujets ou réponses d’une
fugue instantanément, même transposés. Phil Collins adore
accorder les fûts de sa batterie : subtilité qui passera inaperçue
auprès de ceux qui ne reconnaissent pas les hauteurs. Dans ces deux cas,
l’oreille absolue, loin de nuire au plaisir musical, y contribuera...
Pour un ingénieur du son, sur le plan d’une écoute critique
- justesse, problèmes d’accords entre instruments -, elle est également
un plus incontestable.
Qu’en est-il de celui qui écoute de la musique de façon
“récréative”, nous direz vous ? S’il est vraiment
“pris” par la musique, il désactivera automatiquement son
oreille, ne se concentrera plus sur une suite de hauteurs, mais sur les lignes
générales de la mélodie. S’il commence à mettre
des notes sur ce qu’il entend, c’est qu’il s’ennuie...
Un peu comme au cinéma : si le spectateur se met à guetter les
faux raccords à l’arrière-plan, c’est que le film
a quelque peu raté son objectif, qui était au départ de
l’intéresser !
Par contre, une pénible gymnastique intellectuelle s’impose nécessairement
à un instrumentiste doué de l’oreille absolue désireux
d’apprendre à jouer d’un instrument transpositeur. Les notes
qu’il entend ne correspondent pas à celles qui sont écrites
(une clarinette en Si bémol émet cette note quand on joue un Do
écrit sur la partition). De même, un organiste maudira son oreille
absolue quand il devra transposer à vue l’accompagnement qu’il
doit jouer, là où un musicien pourvu d’une oreille “ordinaire”
décalera purement et simplement le clavier et jouera les notes habituelles,
sans être le moins du monde dérangé par le fait que la touche
Do produit un La... Une platine cassettes trop rapide mettra également
au supplice notre auditeur, incapable de supporter une oeuvre connue entendue
un quart de ton trop bas ! Les oreilles absolues fanatiques d’instruments
d’époque sont très troublées par les diapasons à
415 Hz... On se demande d’ailleurs comment faisaient les instrumentistes
affligés de l’oreille absolue à l’époque de
Bach par exemple, où le diapason pouvait varier d’un ton d’une
région à l’autre.
Michel Magne, Nat King Cole, Jacqueline Thibault, Joe Zawinul, Sviatoslav Richter
et André Prévin (chef d’orchestre) la possèd(ai)ent,
tout comme l’auteur de cet article. Mozart aussi, qui était par
ailleurs aussi un surdoué du cerveau, puisqu'il savait, dès l'âge
de trois ans, rejouer de mémoire toute une sonate entendue une seule
fois. Pas d'oreille absolue là-dessous (sauf pour rejouer ladite sonate
dans la même tonalité), mais ce cher Wolfgang était vraiment
un cas ! Alors, pour être au top quand on travaille dans la musique, faut-il
avoir l'oreilel absolue ? Faut-il acheter ces trucs américains promettant
de vous la donner en deux mois (tiens, d'ailleurs, c'est vrai : comment les
oreilles absolues anglo-saxonnes "entendent"-elles les notes ? A,
B, C ???) Relativisons ce débat : la plupart des compositeurs de talent
n’avaient pas l’oreille absolue. Cela tendrait à prouver,
bien qu’elle jouisse d’un prestige certain parmi les musiciens,
qu’elle n’en fait pas forcément des artistes...
Un livre à recommander sur le sujet:
Professeur Claude-Henri Chouard, "L'Oreille musicienne" -
les chemins de la musique de l'oreille au cerveau
Éditions Gallimard, 350 pages - octobre 2001